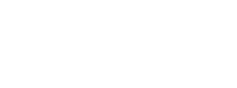Maître Naoki OMI
« Je suis un homme heureux »
Comme le chat de la fable Zen, Omi Naoki est lisse. « Ordinaire » comme il aime dire de lui. Mais derrière cette modestie non feinte d’attitude et de mots, derrière cette absence d’aspérité et d’image de soi projetée vers les autres, il y a une lame au fourreau. D’autant plus aiguisée que Naoki Omi s’est toujours concentré sur l’essentiel. À la rencontre d’un homme tranquille.
RECUEILLI PAR EMMANUEL CHARLOT / PHOTOS : DENIS BOULANGER
UN GARÇON ORDINAIRE
J’habitais à la campagne et il n’y avait aucun club aux alentours. J’étais un garçon très ordinaire, avec des parents qui ne souhaitaient qu’une seule chose pour moi : que je sois heureux. Petit, j’ai fait un peu de sumo et du judo au lycée, mais j’ai surtout travaillé pour passer le concours, afin d’aller à l’université. Quand je suis parvenu à y entrer, j’ai voulu aller au bout d’une idée que j’avais en tête. Faire une pratique de combat piedpoing. J’étais attiré par l’esprit des arts martiaux. Il y avait la possibilité de faire du shorinji-kempo, du karaté et du nippon-kempo, une discipline avec protections et frappes réelles. Je ne sais pas si cela existe encore ! Le karaté était la discipline la plus populaire et j’ai choisi de m’y inscrire, un peu par hasard. Le club de l’université venait de rouvrir. À l’époque, nous y faisions du goju-ryu.
AU DÉBUT, ILS ONT ÉTÉ GENTILS AVEC NOUS…
Le club de l’Université venait de repartir après quelques années de fermeture. Des anciens avaient fait des bêtises, ils s’étaient montrés trop durs. À l’époque, et peut-être encore aujourd’hui, quand l’un des pratiquants faisait un écart, cela se réglait en interne, portes fermées, et la punition pouvait être terrible, cela pouvait aller très loin. Nous étions donc les premiers de ce nouveau départ. Nous sommes partis à quarante. Au début, ils ont été très gentils avec nous. Mais au bout de trois mois, les anciens ont durci l’entraînement et leur attitude. On arrivait plus tôt, pour nettoyer, et ensuite on commençait l’entraînement physique. On en faisait énormément. Il y avait alors peu d’entraînement technique, on se contentait de regarder les anciens. On s’est rapidement retrouvé à onze. Ce n’est pas forcément les plus doués qui sont restés, certains des partants dans mon souvenir étaient bien meilleurs que moi. Pas les moins doués non plus ! Disons les moyens… mais surtout ceux qui avaient de l’endurance mentale. C’était fait exprès. Cette qualité de base, c’est ce que cherchaient les anciens. Ces onze là, ils ont tout fait pour les garder ensuite. Celui qui était malade, ils allaient le chercher chez lui. Pourquoi je suis resté dans ces onze ? Je ne sais pas. Je ne voulais pas partir au bout de trois mois.
UN MODÈLE D’ÉDUCATION
L’entraînement commençait à onze heures, jusqu’à quatorze heures… et souvent plus. Ils ne nous laissaient partir que pour les disciplines importantes. « C’est quoi ton cours ? D’accord, tu peux y aller ». Moi, j’étudiais le droit avec l’idée d’intégrer une entreprise, mais je peux dire qu’à l’Université, je n’ai pas beaucoup travaillé. J’ai surtout fait du karaté. Ils nous frappaient aussi. C’était comme ça à l’époque, on fonctionnait dans un esprit militaire. Ils étaient sévères et très vigilants, nous avions peur d’eux mais, au fond, la plupart n’étaient pas méchants. Bien sûr, il y en a toujours un qui exagère. Il y en avait un de vraiment méchant ! En combat, il lançait les coups de pied de toutes ses forces. Tout le monde se souvient de lui. Pendant deux ans, cela a été très, très dur. Ensuite, c’est devenu plus intéressant, et puis il y a les nouveaux ! Aujourd’hui, c’est différent, il y a les femmes, les enfants… mais je vois que les gens s’interrogent chez nous. La discipline est de retour, les parents veulent que leurs enfants reviennent aux valeurs anciennes. Je connais un professeur de karaté qui demande aux parents l’autorisation de pouvoir frapper leurs enfants, sinon il ne les prend pas. Mais, bien sûr, personne ne souhaite voir son enfant blessé physiquement ou moralement… l’équilibre est difficile à trouver.
MAÎTRE TANI
Nous avions commencé par le goju-ryu, que nous avons fait pendant deux ans. Mais on a appris qu’un ancien très fort enseignait le karaté et nous avons fini par le suivre. C’était maître Tani. C’est comme cela que nous sommes passés à la pratique du shito-ryu. Dans cette région, c’était soi l’un, soit l’autre. Mais pour nous, cela n’a pas fait beaucoup de différence à ce moment-là. Il a fallu apprendre les pinan que nous ne connaissions pas mais, de toute façon, notre entraînement était presque entièrement consacré au combat. Le souvenir que j’ai de maître Tani… c’est qu’il était très rigolo. Il nous faisait rire ! J’ai supposé qu’il était fort car tout le monde le respectait, mais je n’en avais personnellement aucune idée. En plus, il avait une cinquantaine d’années et déjà très mal aux genoux, parce qu’il avait beaucoup donné de coups de pied dans le vide dans sa jeunesse.
JE NE ME SENTAIS PAS TRÈS FORT…
Nous avons relancé l’activité du karaté dans l’université et nous avons eu de bons résultats en compétition. Les combats étaient durs, nous n’avions pas de protections, pas de protège-dents, ni de gants. Mon copain Tomiyama était brillant techniquement, beaucoup plus que moi, et c’est lui qui ouvrait les rencontres par équipes, parce que le premier doit marquer des points. Moi, j’étais le dernier du groupe. C’est celui qui doit préserver les acquis, faire la décision quand c’est nécessaire. C’est une place difficile à tenir… Quand l’équipe d’en face est menée, votre adversaire essaye tout et tente de vous frapper. C’est souvent brutal. Je ne me sentais pas très fort, et je n’étais pas très doué pour marquer les points, mais j’étais le capitaine. Pourquoi il m’avait donné ce rôle ? Je ne sais pas. Peut-être parce que j’étais dur au mal.
L’ÉTÉ À PARIS
Maître Suzuki était à Paris et avait demandé à Maître Tani de lui envoyer des jeunes, car il ne pouvait plus assurer seul. Avec mon copain Tomiyama, en 1972, nous avons pris un billet aller-retour de huit mois. À la fin du séjour, on ne voulait plus partir et on a vendu notre billet de retour. Au début, nous donnions des cours deux à trois fois par semaine, à l’Université d’Orsay, à Dauphine… On prenait le train pour aller à Coulommiers, Esbly. On gagnait juste de quoi vivre. On a vécu deux mois chez Me Suzuki avant de prendre un quatre pièces à quatre rue de Cléry, vers Bonne-Nouvelle, tout près de la rue St Denis ! On allait à l’Alliance Française tous les jours, mais je n’arrivais même pas à dire « rue de Cléry », il y avait trop de R. On était inscrit à la Sorbonne pour la carte et le Restau U, mais on ne comprenait rien. L’été, ce fut les premiers stages dans le midi, en Corse. On a eu de plus en plus d’interventions à faire… Les choses se sont faites naturellement. Pendant longtemps, je me suis dit « vivement les vacances, que je vois mes amis », et je pensais à ceux qui étaient restés au Japon. Et un jour, j’ai compris que mes vrais amis, ceux avec qui j’avais vécu et partagé le plus de choses, étaient ici, en France. Cela fait quarante ans que je suis là et j’y resterai toute ma vie.
LA LIBERTÉ À LA FRANÇAISE
J’aime la France. On m’avait dit que les Français n’étaient pas sympathiques, j’ai compris qu’il fallait juste apprendre à connaître les gens. Votre culture est plus individualiste que la nôtre. Au Japon, on pense toujours collectif. Faire ce que l’on veut sans que personne ne vous dise rien, c’est bien agréable. Mais l’engagement des jeunes japonais, leur sérieux, c’est quelque chose aussi. Quand on est professeur, on aime les élèves qui travaillent ! Parfois, je me demande ce que certains d’entre eux viennent chercher.
J’ENSEIGNE LE SPORT
J’enseigne le karaté comme un sport. Je fais le constat qu’il est difficile de faire sincèrement du karaté comme un art martial à notre époque. Je ne fais donc pas travailler les techniques interdites par exemple. Beaucoup de choses n’étaient pas transmises du karaté comme système de combat réel. Aujourd’hui, c’est de plus en plus compliqué de rechercher ce qui est juste. Et je trouve qu’enseigner l’esprit martial, sans le pratiquer réellement, c’est difficile. L’esprit découle de la pratique. Mais chacun fait les choses à sa façon, même si nous avons eu les même maîtres. Mon ami Tomiyama propose un karaté très « self-défense » par exemple. Les gens aiment ça et c’est intéressant quand on perd aussi en vitesse d’exécution… Mais, moi, j’ai du mal à aller dans cette voie parce que je ne trouve pas cela assez réaliste. Le bunkai, c’est très codifié. Dans un combat réel, on ne sait pas ce que l’adversaire va faire. Je reste donc sur un karaté sportif, qui me paraît plus proche de la réalité finalement. Et je continue l’entraînement en combat avec les élèves. Ma voie personnelle, c’est de chercher un karaté qui demande moins d’effort, qui va vers l’élimination des gestes inutiles. C’est une voie difficile, mais intéressante aussi quand on a commencé à vieillir. À mon âge, on ne cherche plus à devenir plus fort… j’arrive avant les cours et je m’échauffe longuement. Je veux faire du karaté le plus longtemps possible – d’ailleurs je suis obligé car je n’ai pas cotisé à la sécurité sociale au début de ma carrière. Quand je ne pourrais plus montrer, j’arrêterai.
LE GOLF, VALÉRA ET LA CONVIVIALITÉ
Mon passe-temps favori, comme Dominique Valéra, c ’est le golf. Je n’ai jamais joué avec lui, on n’est pas dans le même coin. Au karaté, on est un peu enfermé, l’avantage du golf, c’est qu’on est dehors. J’ai vraiment été très passionné ! J’ai beaucoup de plaisir à retrouver les experts français et japonais régulièrement grâce à la Fédération et à son président Francis Didier. Avant, même avec mes compatriotes, on ne se voyait pas beaucoup. Comme le dit Valéra : « c’est la convivialité qui compte ». On ne cherche pas à changer de style – ceux qui le font, c’est que cela ne va pas bien dans leur dojo – et on a désormais du mal à assimiler des choses nouvelles en profondeur. Mais nous échangeons, c’est agréable et on peut trouver de nouvelles idées pour enseigner ou à offrir à nos élèves.
JE NE CHERCHE PAS À ÉDUQUER
Le karaté en club n’offre pas de sanction à ceux qui ne font pas bien, pas comme en ski par exemple. En ski, si tu fais mal, tu tombes. En karaté, il faut faire de la compétition pour s’en rendre compte. Avec deux entraînements par semaine, je ne cherche pas à éduquer les enfants. Si je peux créer un peu de solidarité et une bonne ambiance entre eux, si je peux donner un peu de karaté, inciter au respect des lieux, des partenaires, c’est un début pour être un bon citoyen. Je n’aime pas l’irrespect et j’essaye de le faire comprendre aux élèves. Pour moi, la valeur principale, c’est l’honnêteté. Être quelqu’un de fiable, en qui on peut avoir confiance, c’est le plus important. En théorie, le karaté devrait nous faire grandir, mais je remarque que ce n’est pas toujours le cas. C’est une question de choix. Après quoi courrez-vous ?
LE COMBAT, UN MOYEN
Tout le monde a peur. Ce qui compte, c’est la façon dont on réagit devant une situation de peur. Il y en a qui se sauvent et parfois c’est une bonne chose mais, parfois, il faut faire face. Dans le combat, on peut transmettre des choses autour de ça. Dans la façon de se comporter. Mais ça passe par les actes, pas tellement par les paroles. Est-ce que j’ai amené quelque chose ici ? Je ne sais pas. Je ne me pose pas tellement la question. J’ai commencé avec certains et ils sont toujours là quarante ans plus tard… C’est qu’ils doivent apprécier. Et récemment, certains de mes anciens jeunes élèves sont venus me dire que j’étais pour eux comme un deuxième père. Cela m’a fait plaisir. Et est-ce que je suis fier de quelque chose ? Je ne raisonne pas comme cela. J’ai fait des erreurs, mais c’est trop tard pour les regretter. Je ne regarde pas tellement derrière moi. Je n’ai jamais couru après l’argent ni après la reconnaissance. Je vis ici avec les gens que j’aime et je suis heureux.♦
EN BREF Naoki Omi Naoki Omi est né à Okayama, au Japon, en 1948. Il débute le karaté à l’Université Doshisha, à Kyoto, au lieu de la pratique de cette discipline au Japon et deviendra capitaine de son équipe. C’est sous l’influence de maître Tani que son groupe aborde la pratique du shito-ryu. À la fin de son cycle universitaire, il est sollicité pour venir en Europe seconder maître Suzuki avec son camarade d’entraînement Tomiyama, lequel finira par suivre Suzuki en Belgique où celui-ci s’installe. Resté en France, Omi y est désormais considéré comme l’un des plus grands experts de shito-ryu en Europe. Membre du groupe Shukokai, puis de l’organisation internationale Kofukan, il se voit décerner le grade de 7e dan hanshi par Me Tani en 1997. Professeur engagé et discret, il passe beaucoup de temps sur les tatamis franciliens, enseignant à Villejuif, Kremlin-Bicêtre, Verrières-le-Buisson, Boissy-Saint- Léger et Vélizy.♦